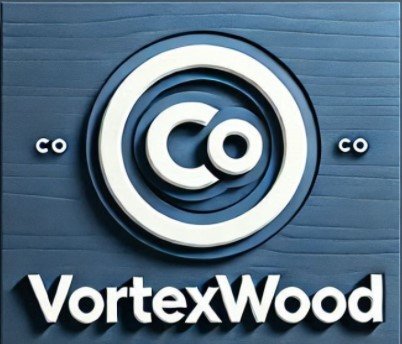Paul Kagame (/pɔl ka.ga.me/N 3, en anglais : /pɔːl kə.ˈɡɑː.meɪ/N 4), né le 23 octobre 1957 à Ruhango (province du Sud, Rwanda), est un homme d’État rwandais, président de la République depuis le 24 mars 2000, après avoir été vice-président et ministre de la Défense de 1994 à 2000. Il est également président de l’Union africaine de 2018 à 2019.
Membre du groupe tutsi, il est commandant dans le Front patriotique rwandais, le groupe armé rebelle qui remporte la guerre civile rwandaise et met fin au génocide des Tutsi en 1994. Par la suite, il devient vice-président et ministre de la Défense, sous la présidence de Pasteur Bizimungu. À son poste, il soutient une invasion rebelle du Zaïre en 1996, menant au renversement du président zaïrois Mobutu Sese Seko en 1997. Il soutient également plusieurs groupes rebelles dans la deuxième guerre du Congo, de 1998 à 2003, contre le nouveau gouvernement congolais de Laurent-Désiré Kabila puis de son fils Joseph Kabila. Après la démission de Pasteur Bizimungu en 2000, il est élu président du Rwanda, réélu en 2003, 2010, 2017 et 2024. Il est crédité d’avoir apporté la croissance économique et la stabilité au pays à la suite du génocide ainsi que d’avoir réduit la corruption dans le pays. Cependant, il est considéré par plusieurs observateurs comme étant un dictateur3,4,5,6.
Situation personnelle
Origines et enfance
Issu d’une famille tutsi7, Paul Kagame naît le 23 octobre 1957 sur la colline de Nyarutovu, dans la commune de Tambwe, province du Sud (ancienne préfecture de Gitarama), près du centre de Ruhango. Il est le fils de Deogratius Rutagambwa (de la famille des Bega) et d’Asteria Bisinda, sœur de Rosalie Gicanda, épouse de l’avant-dernier roi du Rwanda8,9,10. Même si Paul Kagame est républicain, sa famille maternelle est issue du clan Banyiginya, donc de la noblesse11.
En 1961, à l’âge de quatre ans, il quitte avec sa famille le pays en raison des persécutions contre les Tutsis, commencées avec la révolution rwandaise9,12. La famille s’installe à Gahunge, dans le district de Toro, en Ouganda.
Formation et jeunesse
Paul Kagame aurait fait ses études secondaires successivement à la Ntare School de Mbarara, puis à la Old School de Kampala de 1972 à 1976.
À l’âge de 22 ans, en 1979, il rejoint les maquisards venus de Tanzanie sous la direction du futur président ougandais, Yoweri Museveni, dans un mouvement de résistance au régime d’Idi Amin Dada, qui devint la NRA, National Resistance Army, soutenue politiquement, économiquement et militairement par les États-Unis. Plusieurs réfugiés rwandais font aussi partie du noyau de cette rébellion qui renverse ensuite, en 1985, le président Milton Obote, puis en 1986 le président Tito Okello. Après le coup d’État de la NRA en 1986, Yoweri Museveni devient président de la République de l’Ouganda et plusieurs de ses compagnons d’armes rwandais deviennent officiers dans l’armée ougandaise. Paul Kagame est gradé major et obtient un poste important de directeur adjoint des services de renseignement militaire de l’armée ougandaise.
Après son mariage, Kagame est envoyé, en juin 1990, aux États-Unis pour un stage de commandement militaire (Command Staff) à Fort Leavenworth au Kansas12.
Vie privée et familiale

En 1988, il épouse à Kampala Jeannette Nyiramongi, dont la famille était réfugiée au Burundi. Ils sont parents de quatre enfants12.
Guerre civile et entrée sur la scène internationale
Première phase de la guerre civile
Venant d’Ouganda, le 1er octobre 1990, le Front patriotique rwandais (FPR), formé dans les années 1980 par des exilés rwandais arrivés depuis 1959 et dirigé par Fred Rwigema, entre au Rwanda par la force, après des négociations sans succès pour leur retour au pays, déclenchant ainsi la guerre civile rwandaise. Dès le 2 octobre 1990, Fred Rwigema est tué pendant les combatsN 5. La mort de ce dirigeant emblématique est cachée plusieurs jours aux combattants du FPR. Le président ougandais, Yoweri Museveni, parrain du FPR, dont plusieurs responsables se sont illustrés comme officiers dans les rangs de son armée, impose son chef des renseignements militaires, Paul Kagame, vieil ami de Fred Rwigema, pour résoudre cette crise circonstancielle du FPR. Paul Kagame entre sur la scène internationale en prenant les commandes du FPR qu’il avait créé avec Fred Rwigema.
De 1991 à 1993, alternant défaites et victoires militaires, Paul Kagame négocie parallèlement les accords d’Arusha avec le président Juvénal Habyarimana, poussé à la discussion par l’ONU afin de mettre un terme à la guerre civile. Il négocie par l’intermédiaire de Pasteur Bizimungu qui deviendra président de la République pendant la première partie de la période de transition, après le génocide. Avant la période de ces négociations et lors d’un séjour à Paris du 17 au 23 septembre 1991, Paul Kagame est arrêté par les services français une douzaine d’heures, pour terrorisme, juste après avoir été reçu par Jean-Christophe Mitterrand et Paul Dijoud conseillers du gouvernement français pour les Affaires africaines auprès de l’Élysée. Paul Dijoud justifie cette arrestation : « Les accompagnateurs du major Kagame, qui circulaient avec des valises de billets, s’étaient fait repérer par la police et ont été arrêtés, sans que le Quai d’Orsay en ait été averti, puis libérés le soir après l’intervention du ministre des Affaires étrangères »13. De son côté Paul Kagame affirme que Paul Dijoud l’avertit que s’il n’arrêtait pas les combats, tous les siens seraient massacrés14.
Deuxième phase de la guerre civile durant le génocide contre les Tutsi
En 1994, a lieu un attentat contre le président Juvénal Habyarimana, prélude du génocide des Tutsis du Rwanda12. Il mène dès lors les troupes du FPR à la victoire militaire contre les Forces armées rwandaises et le gouvernement génocidaire malgré des troupes inférieures en nombre (15 000 hommes contre 50 000) et des moyens militaires moins importants. L’embargo sur les armes adopté par le conseil de sécurité de l’ONU embarrassait peu les forces gouvernementales, car des réseaux clandestins les approvisionnaient via Goma, au Congo, mais elles mobilisaient beaucoup de leur énergie dans la conduite du génocide des Tutsi qui fit environ 10 000 morts par jour pendant cent jours (soit entre 800 000 et un million de morts) et extermina environ 90 % des Tutsi de l’intérieur du Rwanda. Il a aussi été mentionné des « massacres de civils… et exécutions sommaires par les forces du FPR, apparemment commises à titre de représailles »15, mais sans commune mesure avec le génocideN 6.